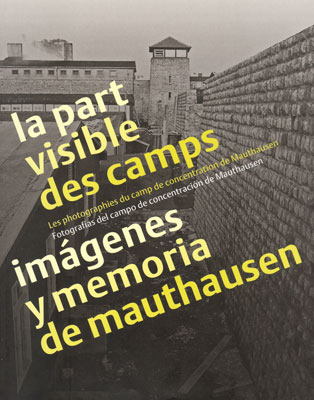 |
Instantanés de mémoire Les
regards photographiques et leurs limites Jean-Marie
Winkler |
| Il nazismo e i campi di concentramento |
«Plus jamais ça» |
mostra fotografica e documentale |
fotografie - Mauthausen, ieri - Introduzione
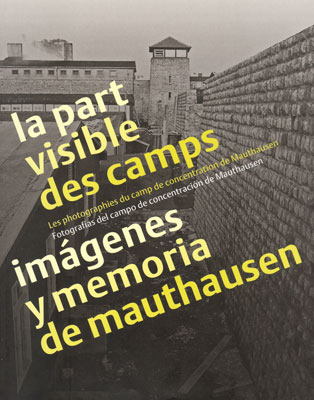 |
Instantanés de mémoire Les
regards photographiques et leurs limites Jean-Marie
Winkler |
Davantage qu'une documentation, le lecteur découvrira ici plusieurs regards portés sur une part de réalité concentrationnaire. Les photographies de Mauthausen sont des documents iconographiques exceptionnels, montrant diverses faces du système concentrationnaire nazi; certains clichés sont devenus de véritables icônes de la déportation. Devant une exposition photographique, a fortiori devant un large fonds de clichés documentaires, le visiteur aura l'impression qu'il s'agit là d'une démarche objective, historique, montrant une réalité non altérée, aux antipodes des témoignages, par essence subjectifs, lacunaires, voire contradictoires. La tentation sera grande de voir dans ces photographies une image fidèle de la réalité concentrationnaire, d'autant plus que la grande qualité technique de la plupart des clichés s'inscrit en faux contre les images floues, les retirages approximatifs que l'on associe d'habitude à la représentation des camps de concentration. Et pourtant... Documenter la réalité concentrationnaire à partir de quelque 500 photographies issues majoritairement d'un fonds SS implique en effet que l'on ait recours à la vision des bourreaux pour tenter d'approcher le vécu des victimes. Or, la fonctionnalité de chaque cliché s'inscrit dans la logique du système concentrationnaire. S'il est aujourd'hui possible de documenter, très minutieusement, la construction de la «forteresse» de Mauthausen, comme on l'appelle, c'est précisément parce que les nazis avaient besoin de prouver à leur hiérarchie administrative et politique le bon avancement des travaux. La monumentalité d'un camp de concentration, en soi une perversité de l'esprit, devait apparaître sur les clichés, si bien qu'il n'y avait pas de place là-dessus pour les concentrationnaires. On sait que les SS étaient logés à l'extérieur du camp; sur les photographies, au contraire, les bourreaux s'immortalisent eux-mêmes, dans un camp vide, où aucune atrocité n'est visible - et pour cause, puisque les exactions quotidiennes et omniprésentes devaient rester cachées. Que dire également de la «banalité du mal», pour reprendre un concept parfois galvaudé, quand les bourreaux SS donnent d'eux-mêmes l'apparence d'une normalité qui ne dira jamais rien de leurs crimes. La monstruosité d'un assassin, d'un tortionnaire pervers ou d'un ivrogne n'y est pas visible. Les SS ont laissé les photos, officielles ou privées, qui les magnifiaient. De même, on ne verra jamais sur ces photographies les autocars de détenus en partance pour le château d'Hartheim, où les invalides et les indésirables étaient gazés. Au lieu de cela, on pourra voir le kommando chargé de la culture des patates... Tant par les conditions de leur production que par les circonstances de leur conservation, les photographies du système concentrationnaire resteront à la fois des documents d'une valeur historique inestimable, et des extraits lacunaires, réducteurs, souvent aléatoires, d'une réalité plus complexe. Pour cette raison, il fut même, un temps, envisagé de disposer au cœur de l'exposition un panneau noir, entièrement vide, signalant concrètement aux visiteurs qu'il existe une part irrémédiablement invisible des camps, soit parce qu'elle n'a pas été photographiée, soit parce que ces photographies trop compromettantes ont été détruites par les bourreaux, ou plus prosaïquement parce qu'elles ont disparu. Les photographies SS parlent le langage nazi, elles véhiculent l'idéologie totalitaire qui est à l'origine du système concentrationnaire. En ce sens, elles témoignent, malgré elles, du nazisme et de l'oppression - à condition d'êtres lues, d'être déchiffrées. Si, au détour d'une image, aux limites du cadrage, un détenu apparaît, souriant, c'est soit qu'il avait reçu l'ordre de sourire, et que tout refus d'obtempérer équivaudrait à la mort, soit qu'il sourit parce qu'il trouve là, l'espace d'une photographie, quelques minutes de vie gagnées, extorquées aux bourreaux. Que dire de la photographie montrant la Strafkompanie sur l' «escalier de la mort», image emblématique de l'horreur à Mauthausen, sinon qu'elle respire l'ordre, la discipline et le rendement, valeurs chères aux bourreaux nazis devenus exploitants de carrière. Il y manque les cadavres remontés par les derniers rangs, les agonisants achevés d'une balle dans la nuque, les coups de trique des gardiens ou des kapos. Cette réalité n'est pas visible ici, sans doute parce qu'elle ne correspondait pas aux objectifs de propagande. Au lieu de cela, on verra les bourreaux triomphants et souriants, montant l'escalier aux 186 marches, une cigarette aux lèvres. Les historiens s'interrogeront sur la facture des marches, que tous les survivants décrivent comme irrégulières, et que la photographie montre parfaites. Montées par un concentrationnaire exténué portant une pierre sur l'épaule, sous les coups des SS et entre les cadavres des compagnons, ces mêmes marches sont beaucoup plus redoutables que celles gravies alertement par les hiérarques nazis en visite de représentation. Le danger serait de faire se substituer à la mémoire vivante des concentrationnaires, qui seuls peuvent témoigner de l'horreur vécue, l'apparente réalité sur papier glacé de ces images. Aucune photographie de la carrière, si impressionnante soit-elle, ne donnera jamais l'idée du bruit assourdissant, ni l'odeur de la poussière; aucune image du camp ne rendra l'odeur de la mort; aucune photographie de l'Appellplatz ne saura jamais exprimer l'écoulement des heures passées là, au garde-à-vous, et dont le cliché isole en le figeant l'instant éphémère d'une fraction de seconde. Il n'y a pas dans l'exposition, au sens strict, de regards photographiques croisés, car chaque vision est autonome, séparée chronologiquement de la précédente, sans interférer avec elle. A la vision SS de l'univers concentrationnaire, surdéterminée par l'idéologie nationale-socialiste et les visées propagandistes d'une image asservie au système, succèdent, sans transition, la Libération, son cortège de manifestations de joie (scène reconstituée dans le cas du camp central, deux jours après la Libération effective), mais aussi la découverte des cadavres entassés, des survivants squelettiques. Le regard des libérateurs, soucieux de réunir les preuves et de documenter l'horreur concentrationnaire, se dessine sur le fond des atrocités nazies, qui sont montrées sans retenue. Le choc des images avait aussi une visée pédagogique, attestée par les réactions de l'immédiat après-guerre, où ces clichés ont bouleversé tous ceux qui les découvraient. Or, le parcours de l'exposition ne s'arrête pas avec la découverte de l'horreur concentrationnaire. On y voit ensuite les photos d'après la Libération, prise par les anciens détenus, jusque dans l'organisation concrète de la liberté retrouvée, la reprise des activités politiques, celles-là mêmes qui avaient valu la déportation et qui avaient été poursuivies, tant que possible, dans la clandestinité au campo. Des clichés tardifs, plus privés, montrent les lieux vides, à l'abandon, vestiges livrés aux herbes folles, à côté des cimetières rappelant combien le complexe concentrationnaire de Mauthausen a été meurtrier. Ces cimetières ont aujourd'hui disparu, de même que la plupart des constructions des camps annexes. Seules les photographies les arrachent encore à l'oubli d'une mémoire défaillante. Le médium photographique rend envisageables des utilisations extrêmes. Pour documenter des «morts non naturelles », les nazis prenaient un cliché du cadavre qu'ils joignaient au rapport administratif. La même duplicité qui veut que les assassins nazis écrivaient «suicide» ou « tentative de fuite » dans la rubrique censée expliquer le décès, conduisait les bourreaux à humilier leurs victimes jusqu'au-delà de la mort qu'ils leur avaient infligée, en les photographiant. Sur certains clichés, la mise en scène macabre ne trompe guère; sur tous, l'objectif réifie une dernière fois les êtres humains dont les nazis ne reconnaissaient pas même l'existence, si ce n'est sous la forme de Stück au sein du système concentrationnaire. Il est vain d'épiloguer sur le flou de certains clichés, qui peut provenir d'un mauvais réglage, ou, au contraire, d'une volonté délibérée, puisque le cliché flou pouvait documenter n'importe quelle mort. La photographie SS ne vise pas à représenter les êtres qu'elle fixe sur pellicule: elle montre les choses, les visages et les corps, tels que les SS voulaient qu'ils soient vus. Dans le cas des concentrationnaires montrés à travers l'objectif des bourreaux nazis, cette photographie équivaut à une humiliation supplémentaire - et cet outrage est paradoxalement destiné à perdurer, puisqu'il est immortalisé sur pellicule. Les mêmes appareils qui servirent aux bourreaux nazis à documenter ce qu'ils estimaient être la gloire d'un Reich millénaire, permirent aussi aux concentrationnaires libérés d'immortaliser les premiers instants de leur survie. Le geste du photographe d'après la Libération, tout comme celui du déporté posant librement devant l'objectif, relèvent de l'affirmation primaire d'une existence de soi, par-delà une mort programmée qui semblait inéluctable. Lorsque les survivants se saisissent des appareils photographiques, ils vont fabriquer l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent opposer aux bourreaux. Là encore, cette représentation du rescapé vu par un photographe qui, lui aussi, quelques jours auparavant, était encore un concentrationnaire, exprime le regard du photographe, tout autant que la réalité du sujet refusant la réification et l'anéantissement auxquels il a survécu. Pour les déportés qui avaient sauvé ces photographies, majoritairement des Espagnols, pour tous ceux qui figuraient sur les clichés d'après la Libération, ces images ont une valeur symbolique forte. Cette ambiguïté structurelle de la photographie, située quelque part entre réification et expression identitaire, est inscrite au cœur du corpus présenté. Le paradoxe n'est pas mince. Cette insoluble dualité marque le parcours du visiteur à travers les différents regards photographiques. Chaque pays a depuis écrit son Histoire. Les différents comités scientifiques ont bien mis en évidence les sensibilités nationales dans l'approche du corpus photographique exposé. La question même du national-socialisme dépasse les clivages nationaux. En Espagne, la guerre civile et la victoire des franquistes, dont le régime survivra à la chute du national-socialisme, oppose des conceptions difficilement conciliables, jusqu'à aujourd'hui. Autre raccourci de l'Histoire, de nombreux Espagnols avaient transité par les camps d'internement français, créés par la République au moment de la déclaration de guerre, puis par les camps de Vichy, avant de retourner en France, à la Libération, puisqu'ils étaient toujours indésirables dans l'Espagne de Franco. En France, la question de la collaboration est inscrite, en filigrane, derrière les images de la déportation, puisque les résistants français étaient escortés, jusque dans les convois, par des compatriotes en uniforme, au service de l'occupant ennemi, tout comme les délateurs français qui avaient envoyé au camp leur voisin ou leur ami. Bien des questions restent dans l'ombre, dès lors qu'il s'agit de délimiter la responsabilité des Français dans les crimes commis sous Vichy. Les Autrichiens fournissaient quant à eux une part importante du personnel SS au sein du complexe concentrationnaire de Mauthausen, et la population pouvait difficilement ignorer la présence de nombreux kommandos de travail disséminés sur l'ensemble du territoire. Mais l'Autriche avait aussi ses concentrationnaires, dont les premiers furent emmenés vers Dachau ou Buchenwald dès avril 1938. Et des Autrichiens étaient détenus à Mauthausen. Pour l'Autriche, victime autoproclamée d'une annexion au Reich qui ne donna lieu à aucun coup de feu, mais à des scènes de liesse populaire, le problème semblait réglé, puisque l'Autriche annexée, l'Ostmark, n'avait pas d'existence légale entre 1938 et 1945, ni même avant 1955, date de création de la Seconde République d'Autriche. Si l'Autriche est longtemps restée en marge du vaste débat sur la culpabilité nationale et le rapport au passé nazi, la Vergangenheitsbewältigung à l'allemande, la fin des années 1980 a marqué une prise de conscience. L'Autriche a récemment entamé un vaste débat, par exemple sur la restitution des biens juifs. Par l'intermédiaire du Ministère de l'lntérieur, auquel a été confiée la gestion du mémorial de Mauthausen, la République d'Autriche devenue souveraine est responsable de la conservation non seulement des pierres et des sites, mais aussi de la mémoire de Mauthausen. En ce sens, la démarche de deux amicales de déportés, unissant leurs efforts sous l'égide du Comité International de Mauthausen pour réaliser une exposition photographique unique, possède une dimension symbolique majeure. Retourner en Autriche, aujourd'hui, pour y exposer la mémoire photographique de Mauthausen, est à la fois une preuve de confiance face à une Autriche ouverte, qui a su affronter son passé national, et un appel à la responsabilité, voire à la vigilance des Autrichiens. La dimension européenne du projet indique la voie à suivre pour les générations futures; le temps n'est plus à l'accusation, mais il n'est pas non plus à l'oubli. Cette exposition n'est pas un aboutissement: elle se veut, au contraire, le point de cristallisation d'un nouveau débat sur Mauthausen et sa mémoire.
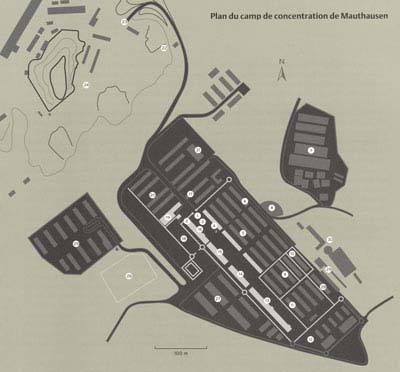 |
Abrégé historique du camp de concentration de Mauthausen |
Au
début du mais d'août 1938, quelques semaines après l'Anschluss, le
rattachement de l'Autriche à l'Allemagne national-socialiste, un camp de
concentration fut fondé à Mauthausen, près de Linz. L'organisation SS voulait
créer un camp pour hommes destiné à augmenter les capacités de détention
dans l'espace autrichien. Après une courte période, les Autrichiens n'étaient
cependant plus majoritaires et des détenus de l'Europe entière furent déportés
à Mauthausen. A l'origine, le camp avait été créé pour exploiter la main
d’œuvre concentrationnaire dans les carrières d'une firme SS, les «Entreprises
des Terres et Pierres Allemandes» (Deutsche Erd- und Steinwerke
GmbH ou
DE5T). Dès les premiers temps, les conditions de vie et de travail, sur le
chantier de construction du camp et dans les carrières, furent extrêmement pénibles.
Les détenus étaient brutalisés jusqu'à la mort, maltraités, battus, exécutés,
victimes d'injections mortelles pratiquées dans le Revier du camp;
nombre d'entre eux mouraient des suites de la malnutrition et de l'épuisement.
Après le début de la Seconde Guerre mondiale, des groupes de détenus furent
ainsi successivement éliminés: des Polonais, tout d'abord, puis des juifs
venus de Hollande ainsi que des Tziganes. Des républicains espagnols, des déportés
«par
mesure de sûreté»
ainsi que
des prisonniers de guerre soviétiques furent également détenus dans le camp
pour y être «exterminés par le travail».
En tant qu'unique camp de niveau III, Mauthausen constituait
en effet un véritable «camp
de la mort».
Les techniques d'extermination y furent à la fois mécanisées et rationalisées.
Entre l'été 1941 et la fin de l'année 1944, des détenus juifs, des malades
et des personnes aux limites de l'épuisement, issus de Mauthausen et de Gusen,
furent régulièrement envoyés à Hartheim, près de Linz, pour y être gazés
dans un institut dit «d'euthanasie».
Plus de 5.000 détenus trouvèrent la mort, entre 1942 et 1943, dans des«
camions à gaz»,
conçus pour l'extermination par asphyxie. Au printemps 1942, Mauthausen fut
l'un des premiers camps de concentration à se doter d'une chambre à gaz, où
furent assassinés plus de 3.500 détenus. Jusqu'à 1942, les fonctions de répression
et d'élimination des opposants politiques et idéologiques prévalaient à
Mauthausen, alors que se poursuivaient les activités économiques des SS. La pénurie
de main d’œuvre, aggravée par la guerre, obligea à un réajustement des
fonctions du campo Les détenus furent alors principalement utilisés dans la
construction et dans l'industrie d'armement au service d'entreprises privées et
publiques. À l'automne1943, des prisonniers furent exploités dans la
construction d'installations souterraines destinées
à abriter les industries stratégiques d'armement. Durant cette période,
Mauthausen devint le centre organisationnel d'un complexe de plus de 40 camps,
alors que se poursuivait la liquidation des détenus les plus faibles, envoyés
des camps annexes vers le camp central. À la fin de l'année 1944,10.000 détenus
se trouvaient à Mauthausen et environ 60.000 à Gusen et dans les camps annexes:
ces chiffres reflètent l'ampleur du travail forcé, à destination de l'économie
de guerre, auxquels étaient soumis les détenus des camps de concentration, en
particulier durant la dernière phase du régime national-socialiste. Le chaos
des derniers mais qui précédèrent la libération entraîna la mort de plus de
50.000 détenus à Mauthausen et dans les camps annexes. Au total, sur les
200.000 hommes et femmes déportés à Mauthausen, 100.000 n'ont pas survécu.
Le 5 mai 1945, l'armée américaine libéra Mauthausen ; l'un des camps annexes,
Ebensee, fut le tout dernier des camps de concentration nazis à être libéré,
le 6 mai 1945.
Photographies
du
camp de
concentration de Mauthausen - un panorama
Stephan
Matyus et Gabriele Pflug
Il
existe un très grand nombre de photographies de Mauthausen, de la construction
du camp de concentration jusqu'à sa transformation en un lieu de mémoire après
1945. Très souvent publiées depuis soixante ans, certaines d'entre elles sont
devenues de véritables icônes du campo La plupart cependant, dispersées à
travers de nombreux pays depuis la fin de la guerre, demeurent inconnues. Le
catalogue de
l'exposition «La
part visible des camps» réunit, pour la première fois, une très large
documentation photographique venue de France, d'Autriche, d'Espagne, de la République
Tchèque et des Etats-Unis. Jusqu'à la libération des camps, les photographies
furent exclusivement réalisées par les SS qui cherchèrent ensuite à détruire
les preuves visuelles de leurs crimes avant leur fuite. Les photographies ne
disparurent cependant pas tout à fait grâce à un groupe de détenus espagnols
qui risquèrent leur vie pour sauver plusieurs centaines de négatifs. La
lecture des photographies de cette exposition n'est pas aisée: leur mise en scène
doit être déchiffrée. Beaucoup semblent, au premier regard, immédiatement
lisibles, certaines au contraire, demandent une analyse détaillée et une
recherche du contexte de leur production. Ainsi, les photographies réalisées
par les SS dissimulent plus qu'elles ne montrent. Elles exigent un regard extrêmement
critique car nombre d'entre elles placent le spectateur dans la même position,
sans distance aucune, que celle adoptée par les SS sur le camp et les
prisonniers. Beaucoup de photographies réalisées par les SS étaient
manifestement utilisées à des fins de propagande. Seule était photographiée
une infime partie de la réalité, consciemment mise en scène, qui montrait une
image propre et lisse de Mauthausen et éludait les atrocités de l'univers
concentrationnaire. Les photographies mettant en scène les SS partagent ce même
principe: l'apologie d'un certain esprit de groupe et la construction visuelle
d'une supériorité venaient cacher leurs véritables actions criminelles. Les
photographies de la libération réalisées après le 5 mai 1945 donnent un tout
autre témoignage sur Mauthausen. Les photographies des libérateurs américains
et notamment ici celles du US Signal Corps (le service d'information
militaire américain) cherchèrent à choquer en multipliant les images d'amoncellements
de cadavres, de fosses communes et de détenus squelettiques. Les images
voulaient exposer ainsi les conséquences de l'idéologie nazie et légitimer l'intervention
américaine en Europe. Avec l'arrivée des Américains à Mauthausen, d'autres
photographes, parmi lesquels d'anciens détenus, des civils et des journalistes,
tentèrent de rendre compte de l'horreur concentrationnaire. Cela donna lieu à
des témoignages photographiques extraordinaires auxquels on avait prêté,
jusque-là, peu d'attention: certains détenus espagnols présentent un point de
vue personnel de la libération, montrant le triomphe des survivants, la reconquête
progressive d'une individualité perdue ou encore l'interrogatoire du commandant
du camp blessé, Franz Ziereis.
La production photographique à Mauthausen : le laboratoire photographique du servite d'identification
A
Mauthausen, des panneaux portaient l'inscription «Attention
- limite du camp.
Interdiction formelle d'entrer, de s'arrêter et de photographier. Tir à vue!».
Seuls les membres du service d'identification (Erkennungsdienst) étaient
autorisés à prendre des images. Créé en 1940 à Mauthausen, ce service
photographique officiel était rattaché directement au bureau politique. Il était
dirigé par deux officiers SS qui employaient plusieurs détenus chargés du développement
et de l'archivage des photographies. Les fonctions du service d'identification
étaient nombreuses: sa principale mission consistait à réaliser une
photographie signalétique à l'entrée de chaque nouveau détenu. Le
laboratoire réalisait aussi des portraits ethnographiques répondant aux
principes de la science raciale du national-socialisme. De plus, le service
photographique SS produisait des relevés photographiques de l'édification du
camp et des reportages réalisés lors d'événements importants: visite des
hauts dirigeants nazis comme Heinrich Himmler, capture de détenus évadés,
arrivée de grands convois ou encore exécutions publiques. Les photographies
des ateliers, des carrières ou des camps annexes devaient, en outre, mettre en
valeur la productivité et l'efficacité économique du complexe de Mauthausen.
Enfin, une part considérable de l'activité photographique était consacrée à
l'autoreprésentation des gardiens et officiers du camp: portrait d'identité,
portraits officiels, cérémonies militaires, faisaient partie du quotidien de
ce service. Les photographies officielles des SS devaient fournir une image de
la sévérité extrême du régime concentrationnaire. Elles ne dissimulaient
pas la discipline et l'asservissement auxquels étaient soumis les opposants
politiques ou les membres des «races
inférieures»
tels
les juifs et les Tziganes. Et pourtant, elles sont
loin de tout révéler sur le fonctionnement du campo Aucune des exécutions de
masse n'était documentée. On ne trouve également aucun cliché officiel des
exécutions par le gaz, par injections intra-cardiaques ou par aspersion d'eau
froide (qui consistait à provoquer la mort par refroidissement en soumettant le
prisonnier à des douches froides de plusieurs heures). Manifestement, montrer
la violence quotidienne, l'hygiène très insuffisante ou les conditions de vies
catastrophiques des prisonniers ne relevait pas des devoirs des photographes SS.
Certes, il existait des photographies d'assassinats pendant une «tentative
d'évasion
», mais elles jouaient pour les SS un rôle purement administratif. Lorsqu'ils camouflaient
les meurtres sous l'appellation de «tentative
d'évasion», une lourde procédure bureaucratique était engagée sous le titre
de « mort
non naturelle». Il fallait
alors produire un témoignage, rédiger des rapports et réaliser des esquisses
ou justement des photographies du lieu du crime.
|
Francisco Boix muni d'un appareil photographique devant une baraque du camp. Mauthausen, 1945 |
L'histoire
du fonds
photographique : un acte de résistance |
Anna Pointner e ses duex filles entourées de républicains espagnol, devant leur maison au village de Mauthausen. 1945 |
«Quelqu'un,
un jour, saura-t-il ce qui s'est passé? Est-ce que l'on nous croira lorsque nous
raconterons?» Ces
questions obsédaient les détenus des camps de concentration.
Seuls quelques-uns d'entre eux avaient la possibilité de rassembler des preuves,
surtout ceux qui travaillaient directement dans l'administration SS. lIs tentèrent,
au péril de leur vie, de dérober des documents, de les recopier et de les
cacher ou de les faire sortir par contrebande hors du campo. Ils espéraient
qu'un jour ce matériel prouverait la culpabilité des criminels nazis. S'il
existe encore de nos jours des photographies des camps prises par les SS, c'est
en grande partie grâce au courage d'anciens détenus de différents camps. Le
destin du détenu Rudolf Opitz qui travaillait au laboratoire photographique de
Buchenwald et qui fut exécuté pour avoir tenté de cacher des photographies témoigne
bien du risque immense qu'encouraient les détenus de Mauthausen. Ce
sont principalement des détenus espagnols qui organisèrent le sauvetage des
photographies de Mauthausen. Dans le laboratoire photographique SS,
travaillaient normalement six détenus, parmi lesquels un Autrichien, plusieurs
Polonais et deux Espagnols (Antonio Garda et Francisco Boix) qui étaient arrivés
en avril 1941 dans le campo Les deux alertèrent le groupe de résistants des républicains
espagnols pour signaler l'existence de négatifs remisés dans des boîtes et
laissés sans surveillance. Ramon Bargueno, Santiago Bonaque, Julios Capellias,
Mariano Constante, Florencio de la Fuente, Joan Pagès, José Perlado et Manuel
Razola s'organisèrent en filière. De mars 1942 jusqu'à la libération, des
morceaux de négatifs enveloppés dans du papier journal furent sortis du
laboratoire et déplacés dans divers ateliers où ces hommes travaillaient,
comme la menuiserie, la désinfection ou l'atelier de réparation des fenêtres.
Ils cachèrent ces pochettes dans de nombreux recoins, dans les caisses à
outils ou sous le
plancher des baraques ou
dans
les montants des portes. Pendant quelques semaines, des pochettes furent cousues
dans les épaulettes de l'uniforme de plusieurs détenus. Environ une trentaine
d'actions de ce genre furent menées. Les Espagnols privilégiaient les
photographies les plus compromettantes pour les SS, en particulier les
assassinats et les humiliations de détenus. Quand,
à partir de 1944,
les
conditions de vie se détériorèrent gravement, les dirigeants de l'opération
tentèrent de sortir les photographies du camp. Ils firent appels aux jeunes
Espagnols du Kommando «Poschacher»
(voir
p. 36). Ces jeunes devaient travailler dans les carrières de l'entrepreneur
Anton Poschacher en tant qu' «apprentis-Poschacher».
Parmi eux, Jesus Grau et Jacinto Cortès reçurent dans les cuisines des négatifs
qu'ils cachèrent pour certains dans des boîtes de pastilles, pour les sortir
du campo. En 1945, ils tentèrent une manœuvre extrêmement risquée. Les SS
avaient organisé une partie de football entre eux, devant le campo. A
cette
occasion, les détenus cachèrent les pochettes de négatifs dans les chaussures
de sport des joueurs, les portèrent ainsi jusqu'au portail du camp et purent
les donner pendant le match à un jeune « Poschacher».
Anna Pointner, une résistante autrichienne, qui habitait au village de
Mauthausen et qui avait pris contact avec les jeunes Espagnols, accepta, malgré
le danger pour elle et sa famille, de dissimuler la boîte de négatifs dans le
mur de son jardin. Le 5 mai 1945, tout de suite après la libération le groupe
des Espagnols récupéra cette collection. Elle fut alors complétée par des négatifs
retrouvés au laboratoire et par des portraits de SS dissimulés par Casimiro
Climent Sarrion, détenu espagnol qui travaillait au service politique du campo.
Dans les jours suivant la libération, Francisco Boix, qui travaillait
jusqu'alors au laboratoire photographique des SS, utilisa les appareils laissés
en place pour effectuer de très nombreuses photographies du camp qui offrent
sur le camp et les survivants une tout autre perspective que celle des libérateurs.
Devant l'objectif du photographe s'opère la métamorphose des détenus en
survivants qui se présentent comme témoins du temps et soulignent leur
inflexible esprit de résistance. Les images de cette transformation d'identité
marquent un état décisif dans la vie des prisonniers qui, après des mais et
des années de détention, retrouvent le difficile chemin vers la normalité et
une vie autonome et libre. Dans cette perspective, le photographe ne devient pas
seulement le témoin des identités des détenus en redéfinition, mais, face à
ses camarades, il participe aussi de cette nouvelle conscience de soi. En
outre, Boix
fit développer un grand nombre de négatifs SS dont il légenda les tirages au
verso. Ce fond de plus d'un millier d'images fut ensuite dispersé entre
plusieurs Espagnols qui les rapportèrent en France dans des enveloppes ou dans
des pochettes trouvées au laboratoire photographique.
|
Habitants de Linz devant une exposition de photographies de Mauthausen prises par le Signal Corps à la libération. Linz, 1945 |
La
diffusion des photographies de Mauthausen après 1945 |
Peu
de temps après la libération de Mauthausen, les photographies connaissent une
diffusion considérable dans la presse internationale. En
Autriche,
les populations locales sont informées de l'horreur des crimes commis dans leur
région par des murs d'images placés dans les lieux publics. Ces photographies
des libérateurs façonnent pour longtemps l'image collective de Mauthausen.
Beaucoup d'Espagnols survivants partirent en France. Le retour en Espagne leur
était interdit en tant qu'opposants à Franco. Certains possédaient les négatifs
des photographies des SS ainsi que les images de la libération, qui commencèrent
à être diffusées dans la presse communiste (Regard,
Ce soir).
Par
l'intermédiaire de
Francisco Boix, des photographies paraissent dans des journaux et des livres qui
rappellent l'acte de résistance dont certaines d'entre elles proviennent et
leur valeur particulière. Boix est appelé comme témoin au procès de
Nuremberg et comparait les 28 et 29 janvier 1946. A
cette
occasion, il
présente
à la Cour, face aux
plus hauts dirigeants du régime nazi, une trentaine de photographies du campo.
Ces déclarations accompagnant les photographies contribuèrent à faire
condamner Ernst Kaltenbrunner et Albert Speer. A la mort de Boix, en 1951,
le
fond des photographies prises par les SS est éparpillé entre plusieurs mains:
d'anciens détenus espagnols conservent des collections personnelles d'images;
en France, diverses organisations comme la Fédération Nationale des Déportés,
Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), l'Amicale française de Mauthausen
qui regroupe les anciens déportés du camp, le journal L'Humanité, recueillirent
des photographies. Quelques photographies furent rassemblées par les Archives
photographiques des monuments du camp de concentration de Mauthausen dépendant
du Ministère Fédéral autrichien de l’Intérieur, à
Vienne (Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen des österreichischen
Bundesministeriums
für Inneres). Les
recherches pour l'exposition menèrent également à
exploiter
les très nombreux négatifs des SS du Museu d'Història de Catalunya (Barcelone),
ainsi que les archives privées de Mariano Constante. Depuis 1970, les anciens détenus
de Mauthausen comme Joan Pagès en Espagne, Hans Maršálek en Autriche, Paul Le
Caër et Mariano Constante en France, rassemblent à nouveau ces
images éparpillées depuis 1945.
Avec
l'exposition «La
part visible des camps»
et
son catalogue, ce rassemblement est enfin achevé symboliquement.
da
«La part visible des camps – Les photographies du camp de concentration de
Mauthausen» - Editions Tirésias – Catalogue de l’exposition du homonyme,
Wien 2005